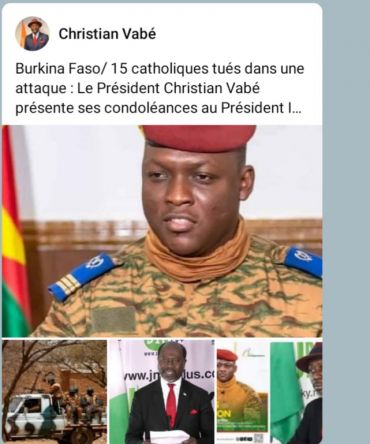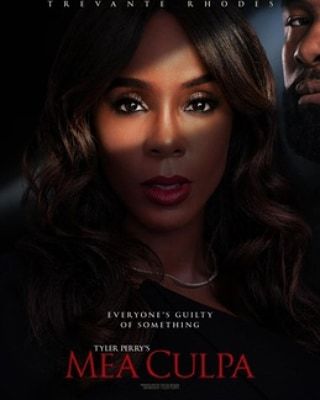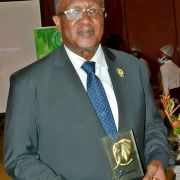Débats et Opinions: Blaise Compaoré et Alassane Ouattara au service de la France et non des africains
Par Correspondance particulière - Blaise Compaoré et Alassane Ouattara au service de la France et non des africains

Les populations burkinabé qui se sont opposées au coup d’État
constitutionnel du président Blaise Compaoré sont des partisans de la
démocratie et non des putschistes. Il nous faut lever toute équivoque,
quant à la subtilité, à la complexité des expressions, des mots que nous
utilisons, dans le but d’éviter tout amalgame susceptible de jeter un
éventuel discrédit sur leur lutte politique. Du XVIe au XVIIIe siècle,
l’expression coup d’État désignait, en fait, l’emploi de moyens
extraordinaires par les souverains (ou le pouvoir politique) pour rétablir
ou conforter leur pouvoir. Vers la fin de la Révolution française
l’expression : "coup d’État" désigne, par extension, un renversement du
pouvoir, de façon illégale et souvent brutale ; lorsque la force est
employée pour s’emparer ou pour conserver le pouvoir. Affirmer que le
président Blaise Compaoré a tenté, à partir d’un referendum, un coup
d’État constitutionnel, n’est donc pas erroné puisque son objectif
principal était de conforter son autorité sur le peuple burkinabé, de
préserver ses intérêts et ceux de son clan, en demeurant président à
vie. Tout Chef d’État qui utilise des moyens extraordinaires pour
conserver le pouvoir au détriment du peuple fomente un coup d’État contre
ses populations, qui ont le droit de choisir librement leurs propres
représentants dans toute nation dite démocratique. Contraint par le peuple
souverain à mettre fin à son mandat présidentiel qui n’est pas encore
achevé, Blaise Compaoré, il est bon de le relever, n’est pas victime
d’un putsch, qui aurait été perpétré, planifié par l’opposition
burkinabé. Il s’agit ici de distinguer le putsch d’une révolution. Si
le putsch est un coup d’État réalisé par la force des armes, la
révolution est populaire. Nous avons donc assisté au Burkina Faso à une
révolution, qui concède à l’opposition toute légitimité pour organiser
des élections transparentes, démocratiques, avec le soutien des armées,
dont le rôle est de maintenir l’ordre, la paix, de "prévenir
l’apparition d’ennemis" qui menaceraient l’intégrité territoriale, la
souveraineté du peuple. Cette révolution des populations burkinabé
s’inscrit, cependant, dans un processus historique qu’il nous faut
analyser pour aider nos frères démocrates burkinabé à mieux affronter les
nouveaux défis qui les attendent. Ignorer certaines réalités historiques
conduirait cette énième révolution à un échec cuisant, puisque
l’objectif principal d’une révolution est de se libérer d’une
condition de servitude dans laquelle est maintenue, en général, le peuple.
Attribuer seulement à Blaise Compaoré et à son clan la responsabilité de
la misère du peuple Burkinabé, c’est avoir une conception simpliste du
système politique oppressif dans lequel les peuples africains sont
enfermés. Si les bases d’une démocratie véritable ne sont pas jetées au
Burkina Faso, dans le but de construire des institutions fortes, intègres,
nous verrons apparaître d’autres Blaise Compaoré soutenus par le clan du
président déchu, par la France et Ouattara qui plongeront le pays des
hommes intègres dans les affres d’un enfer politique, économique plus
cruel. Deux faits paradoxaux récents nous aideront à mieux analyser ce
processus historique: Compaoré, chassé du pouvoir par son peuple, pour
avoir tenté un coup d’État constitutionnel est protégé par le
président français Hollande, qui lui trouve un refuge en Côte d’Ivoire,
où il n’est pas inquiété par la CPI, malgré toutes les accusations
portées à son encontre qui lui imputent de nombreux crimes contre
l’humanité. Le président Gbagbo garant de la Constitution de notre pays,
Chef suprême des Armées, qui a défendu son pays contre une invasion
étrangère et a toujours souhaité une issue pacifique au contentieux
électoral ivoirien, en demandant le recomptage des voix pour savoir qui de
lui ou d’Alassane Ouattara est le véritable vainqueur des élections
présidentielles eut, au contraire, sa résidence bombardée par les forces
françaises. Contraint à abandonner le pouvoir, il est arrêté par la
France et porté devant les juges de la CPI. Pourquoi deux poids deux mesures
? La réponse spontanée est assez simple : Compaoré
défend les intérêts de la France, en maintenant, comme Alassane Ouattara,
« son peuple » dans une condition de servitude, Gbagbo, un partisan de la
démocratie, refuse d’en faire autant. Ces deux faits nous aident à mieux
aborder le passé du peuple burkinabé qui aidera les populations burkinabé
à affronter le présent et à préparer le futur. Il nous, avant tout,
rétablir une vérité historique fondamentale : en septembre 1932 la Haute
Volta (actuel Burkina Faso) fut dépecée par la France au profit du Soudan
français (le Mali actuel), du Niger et du Burkina Faso malgré les
protestations du Mogho Naba (ou Morho Naba) à cause, principalement, de leur
capacité à se rebeller contre toute forme d’oppression, de domination. Le
puissant empire du Mali en a fait les frais, quand en 1329 le Yatenga (avec
pour roi le Morho Naba) conquit Tombouctou. L’aristocratie militaire des
Mossis faisait de chacun d’eux des résistants potentiels, ce qui
constituait un mauvais exemple pour les habitants des autres colonies. Il
nous suffit de rappeler l’insurrection de Dédougou en 1915. Pour affaiblir
et pacifier ces sujets intègres, disciplinés, soumis totalement à leurs
monarques et non à des envahisseurs étrangers, la France décida de
supprimer les frontières de la Haute Volta et évoqua, comme motif de cet
acte politique odieux, la pauvreté de cette colonie. Si des nations
devraient être supprimées à cause de la pauvreté de leur territoire, la
France, elle-même, qui tire ses richesses de ses colonies n’existerait
plus. Cette décision obligea le Morho Naba à collaborer avec les autorités
politiques de la Métropole, puisque le souverain Mossi adressa une lettre au
président Vincent Auriol, afin que soient restaurées les frontières de son
pays. Les colons français avaient trouvé sur notre sol des africains
organisés qui avait une remarquable cohésion sociale dont voulurent
s’inspirer certains leaders africains à l’aube des « indépendances ».
Si l’aristocratie militaire des mossi avait inculqué aux membres de leurs
tribus une qualité morale indéniable ; leur intégrité morale, et une
combattivité enviée par tous, les conquêtes des monarques de l’empire du
Mali (de Soundiata Kéïta) et leur organisation politique, administrative,
avaient fait des fils du Mandingue des sujets fiers de leur passé glorieux.
Le président Thomas Sankara voulut, à dessein, s’inspirer de la qualité
morale de ses ancêtres, de leur endurance au travail, pour bâtir une nation
burkinabé autonome, libre, et non assujettie au dictat de la Métropole. Son
héritage et son programme politique sont inscrits dans le nom du pays : «
Burkina Faso (le pays des hommes intègres) ». Ses idées souverainistes
étant incompatibles avec les intérêts de la métropole, il fut assassiné
durant le coup d’État le plus sanglant de l’histoire de ce pays, et
arriva au pouvoir Blaise Compaoré, le militaire dont le « règne » fut le
plus long. Ce président-fantassin a permis à la France de réaliser son
projet colonial originel, en faisant des burkinabé une main d’oeuvre et
des fantassins au service des intérêts de la Métropole. A la tête de
leurs sujets burkinabé, a été, naturellement, installé, sous Compaoré,
une aristocratie militaire (sur le modèle de la société traditionnelle du
Yatenga) chargée de maintenir les burkinabé sous le joug colonial, et de
nier aux peuples voisins, qui aspirent à la démocratie, la réalisation de
leurs rêves. Ce qui explique la présence de Compaoré dans presque toutes
les rebellions qui ont endeuillé l’Afrique. Un autre leader politique
africain, bien avant Thomas Sankara, avait voulu s’inspirer du génie de
ses ancêtres (Soundiata Kéïta) pour bâtir une Afrique fédérale. Il
s’agit de Modibo Kéïta, qui prônait, face à la politique coloniale
déshumanisante, la construction de la Fédération du Mali. La France usa
d’une stratégie politique courante pour faire avorter ce projet. Aux
partisans de la Fédération, la Métropole proposa un autre leader
politique, en la personne de Senghor, qui avait pour rôle de conquérir la
présidence de la Fédération, afin d’écarter Modibo Kéïta, un
panafricaniste convaincu. Elle accompagna aussi le projet politique des
partisans de l’autonomie des colonies (de la Loi-cadre), en apportant leur
soutien discret à Houphouët Boigny, président du RDA (le Rassemblement
Démocratique Africain) et à Maurice Yaméogo, premier président du Burkina
Faso. La France, grâce à cette stratégie
politique, contrôlait les deux courants politiques des mouvements africains,
dans le but de corrompre de l’intérieur leurs conceptions politiques
originelles. Alassane Ouattara installé à la tête de la Côte d’Ivoire
par l’armée française avec l’aide de Compaoré et de son aristocratie
militaire est l’archétype de ce projet colonial français. Il se sert du
rêve des fils du mandingue, soucieux de bâtir la Fédération du Mali pour
restaurer, en réalité, les frontières de l’empire colonial français :
l’AOF (l’Afrique Occidental française). Une fois à la tête de la Côte
d’Ivoire, Ouattara prend en otage l’héritage politique d’Houphouët,
le PDCI-RDA, le transforme, progressivement, en PDCI-RDR, dans le but d’en
faire un parti politique hybride, étranger à ses racines historiques qui
inspirent ses hommes politiques, puisque le passé permet de construire le
présent et de prévoir le futur. Pour arriver à ses fins, Ouattara flatte
la fierté légendaire des Ivoiriens, en proposant à son leader politique
Bédié, des « pacotilles » qui portent son nom (sa griffe) ; des ponts
etc… Ainsi la Métropole, par l’entremise d’Alassane Ouattara et Blaise
Compaoré est arrivée à corrompre l’identité morale, culturelle,
anthropologique, de chacune de nos populations, pour installer à notre tête
un système politique oppressif corrompu qui n’est qu’une mutation du
système colonial français. L’intégrité des burkinabé est devenue sous
Compaoré une obéissance servile, aveugle, au dictat de la Mètropole,
l’héroïsme des fils du Mandingue et leur grand nombre est au service de
l’épuration administrative et ethnique en Côte d’Ivoire, la fierté
légendaire des Ivoiriens se résume à des postes politiques importants mais
vides, à des sucettes et à des bonbons, comme le disait le grand
intellectuel et académicien Senghor. Gbagbo emprisonné à la CPI,
Compaoré, le maniaque des coups d’État exfiltré par la France et
réfugié auprès de Ouattara, qui se veut le Soundiata Kéïta des temps
modernes au service, cette fois-ci, de la Métropole et non de ses
populations, ne sont que l’aboutissement d’événements politiques qui
s’inscrivent dans un processus historique : le projet colonial français.
L’opposition burkinabé ne peut jeter les bases de la démocratie que si
elle sort de ce processus historique, cette condition de servitude, dans
laquelle nous maintient la Métropole. En Côte d’Ivoire sont réunis
désormais les deux tentacules de la Pieuvre (de la Françafrique) : Ouattara
et Compaoré, prêts à restaurer l’ordre colonial au Burkina Faso
puisqu’ils sont le fruit de l’alchimie des autorités politiques
françaises.
Une contribution par Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)